
Il y a, dans les couloirs des aéroports de Paris, des femmes qui exercent un métier que personne ne regarde et que tout le monde utilise. On les appelle, avec une condescendance qui en dit long sur notre époque, les « dames pipi ».
Elles nettoient après le passage des autres, sans bruit, sans gloire, sans reconnaissance. Mais leur travail, lui, est réel. Il est utile. Il est honnête.
Elles n’ont besoin de mentir à personne pour justifier leur présence.
La chronique tardive de Madame Diop, publiée cinq jours après le conseil municipal du 5 février, relève d’une tout autre logique.
Elle aussi nettoie après le passage des autres. Mais ce qu’elle nettoie, ce ne sont pas des sols. Ce sont des réputations.
Ce qu’elle astique, ce n’est pas un espace public. C’est l’image d’un pouvoir.
Et contrairement aux premières, dont la dignité tient à la vérité de leur geste, cette chronique n’a pour matière première que la démolition méthodique de chaque opposant — dans l’espoir, peut-être, qu’on laisse une pièce dans la soucoupe de la reconnaissance municipale.
Car ne nous y trompons pas. Ce texte n’est pas un témoignage. C’est un tir groupé. Le candidat citoyen ? Quinze minutes de présence, donc indigne.
L’élu historique ? Quarante ans de service, donc suspect. Les socialistes ? Des traîtres. La droite ? Du bruit sans idées.
Chaque opposant est ciblé, calibré, neutralisé avec une précision qui n’a rien de spontané. Cinq jours de gestation pour un texte qui sent le relu, le validé, le corrigé par des mains qui ne sont manifestement pas les siennes.
Nos anciens disaient qu’on reconnaît la peur d’un homme non pas à ce qu’il fuit, mais à ce qu’il attaque. Et Madame Diop attaque tout. Tout le monde. Systématiquement.
Mais que tait-elle, cette chronique si bavarde ? Elle tait les taux d’imposition parmi les plus élevés du département. Elle tait la piscine vétuste, promise, jamais rénovée. Elle tait les sondages à 30 000 euros dont nul ne connaît le commanditaire. Elle tait le budget communication qui enfle pendant que les services publics s’essoufflent.
Il est tellement plus commode de compter les minutes d’un adversaire que de rendre compte des années d’un bilan.
Plus troublant encore : trois citoyens accompagnent un candidat dans une séance publique et voilà que l’atmosphère « se tend », que des « regards insistants » deviennent menaçants.
Voilà où mène un pouvoir qui se croit propriétaire de l’espace démocratique : le citoyen qui observe devient suspect, celui qui questionne devient nuisible. Celui qui se lance en politique, une menace et une autre nouvelle cible à abbatre.
Frédéric Hernandez a trouvé le mot juste, celui qui perce la baudruche d’un seul coup d’épingle : « Vous devez être aux abois pour venir démonter tous les candidats. C’est tout simplement pathétique. »
Parfois, une phrase de bon sens pèse plus lourd que toutes les officines de communication réunies.
Car on n’envoie pas ses soutiens démolir chaque adversaire quand on est serein. On ne publie pas des pamphlets déguisés en récits quand on a confiance en son bilan. Seul le vide a besoin de tout cela.
Les miroirs que nous tendons aux autres finissent toujours par nous refléter nous-mêmes. Et celui de Madame Diop n’a pas montré les faiblesses de l’opposition.
Il a montré les tremblements d’une majorité qui sent le sol se dérober.
À la fin, ce ne sont jamais les chroniques tardives qui font les bilans. Ce sont les actes. Et les actes, eux, n’ont besoin de personne pour parler.
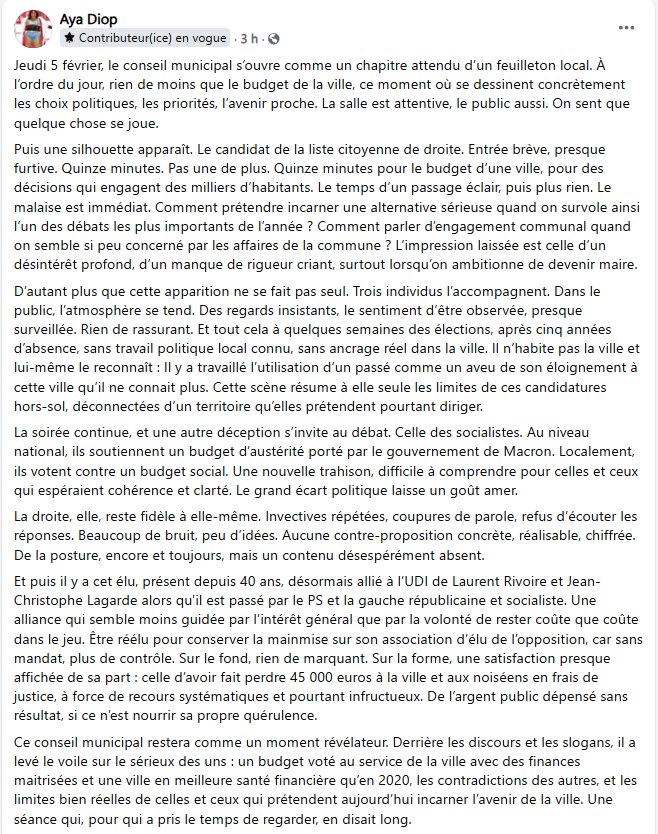
Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.