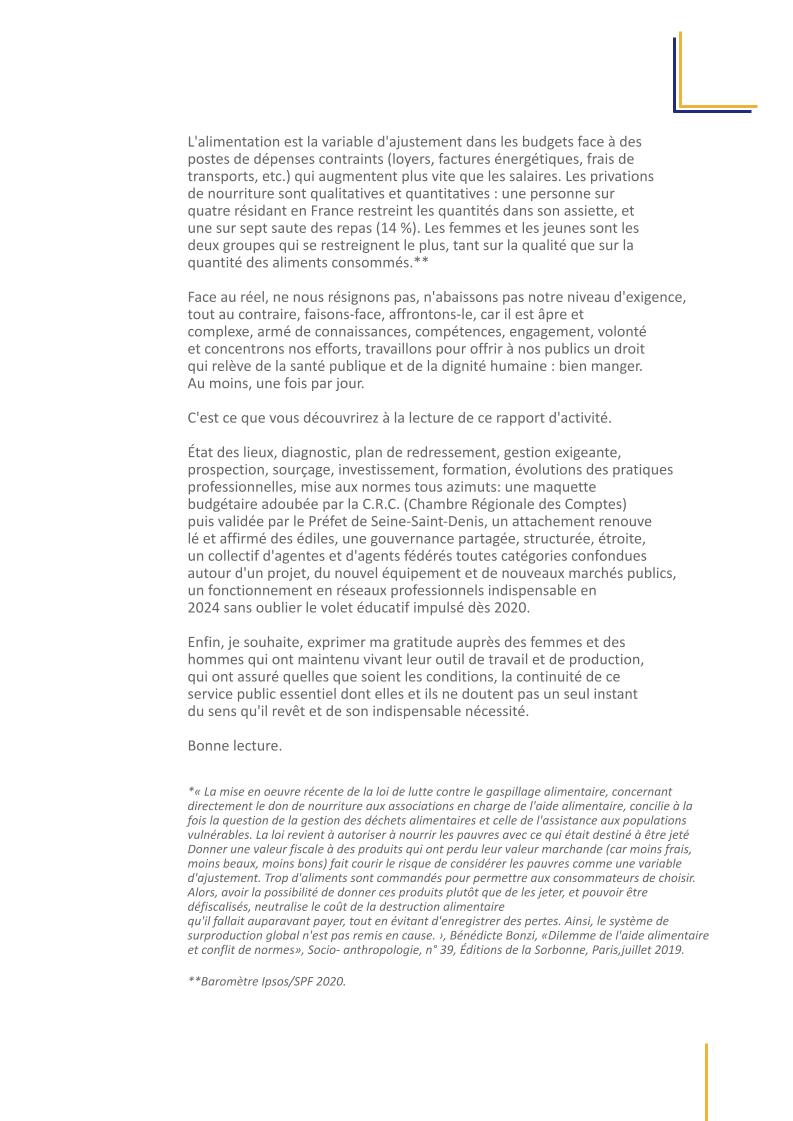La lecture de l’éditorial, signé par la présidente du syndicat intercommunal, m’a conduit à une décision inhabituelle : consacrer une analyse approfondie à ce texte introductif. Non par goût de la polémique, mais parce que ce document soulève des questions essentielles sur la cohérence entre discours institutionnel et réalité gestionnaire.
En tant que citoyen attentif aux modalités de gestion de nos établissements publics intercommunaux et soucieux de la transparence démocratique qui doit présider à toute administration des deniers publics, je me propose d’examiner, avec la rigueur qu’impose l’exigence républicaine, cet éditorial qui mérite d’être décrypté.
Madame Julie Grünebaum possède indéniablement une plume remarquable et une maîtrise certaine de la rhétorique administrative. Ces qualités littéraires, pour appréciables qu’elles soient, ne sauraient toutefois se substituer aux réponses concrètes que les citoyens noiséens sont en droit d’attendre concernant la gestion d’un service public aussi essentiel que la restauration scolaire.
Éclairage et décryptage…
Dans les communes urbaines de la petite couronne, on apprend très tôt l’art délicat de présenter les échecs comme des victoires. Certains le font avec des graphiques colorés, d’autres avec des discours enflammés.
Julie Grünebaum, elle, avait choisi Marcel Mauss et la sociologie pour habiller son rapport.
Car voyez-vous, lorsqu’un syndicat frôle la dissolution, mieux vaut citer les grands penseurs que reconnaître simplement : nous avons failli.
Aussi, lorsqu’un document officiel commence par citer Marcel Mauss, célèbre sociologue, et sa théorie du « fait social total », le citoyen attentif comprend immédiatement qu’il ne lira pas un simple compte-rendu de gestion.
On lui annonce plutôt un exercice philosophique et sociologique.
Cette élévation intellectuelle, pour légitime qu’elle soit dans certains contextes académiques, mérite toutefois d’être confrontée aux réalités concrètes et prosaiques de la gestion d’un syndicat intercommunal en charge de la restauration scolaire et donc de nourrir chaque jour nos enfants.
I. Les aveux masqués : quand le diagnostic devient réquisitoire
Citation 1 : La reconnaissance d’une dérive institutionnelle
L’éditorial pose un constat d’une franchise rare :
« D’innovant à l’aune du 21ème siècle, il s’est usé jusqu’à risquer sa dissolution : vétusté, absence d’investissement, de régulation organisationnelle (…) gestion strictement comptable de court terme et parcellaire (…) arbitrages non éclairés par une connaissance technique approfondie »
Ce qu’il faut comprendre : Ces lignes constituent l’aveu explicite d’un échec gestionnaire majeur. Le syndicat aurait été au bord de la dissolution. Les termes employés ne souffrent aucune ambiguïté : « vétusté« , « absence d’investissement« , « arbitrages non éclairés« , « gestion de court terme ». Il s’agit d’un réquisitoire en règle contre la gouvernance antérieure. Mais Qui dirigeait donc cet établissement pendant cette période de dégradation ?
La question élémentaire que ce passage soulève : Qui donc présidait aux destinées de cet établissement lorsqu’il périclitait ainsi ? Les éléments publics consultables indiqueraient que Madame Sonia Bakhti-Alout, aujourd’hui vice-présidente et signataire implicite de ce rapport collectif, aurait exercé la présidence du SIPLARC de juin 2020 à décembre 2023. Soit précisément durant la période où, selon le rapport lui-même, les budgets 2022 et 2023 se seraient révélés « insincères« , où aucune augmentation tarifaire n’aurait été votée pendant douze années consécutives, et où le déficit se serait creusé inexorablement.
Nous sommes donc confrontés à une situation singulière : une vice-présidente qui avaliserait, par sa participation à l’équipe dirigeante actuelle, un diagnostic accablant de sa propre gestion passée. Hallucinant ! Cette autocritique involontaire constitue, il faut le reconnaître, un exercice d’une rareté remarquable dans la communication institutionnelle.
II. L’alchimie sémantique : transformer la tutelle en triomphe
Citation 2 : La « validation » préfectorale
L’éditorial poursuit avec une affirmation présentée comme un succès :
« Une maquette budgétaire adoubée par la CRC puis validée par le Préfet«
Ce qu’il faut comprendre : Cette formulation, d’une élégance administrative consommée, opère une transmutation remarquable de la réalité procédurale. Les faits tels qu’ils ressortiraient des documents publics dessinent un tableau sensiblement différent :
- Le budget 2024 aurait été rejeté par le comité syndical lors de sa séance du 12 avril 2024
- Le Préfet aurait été contraint d’intervenir en application de l’article L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales
- La Chambre Régionale des Comptes aurait été saisie d’urgence en raison du dépassement du délai légal de vote budgétaire
- Le SIPLARC aurait ainsi évité de justesse une mise sous tutelle formelle
Qualifier cette intervention préfectorale de sauvegarde de « validation » relève d’un choix sémantique audacieux. Dans le langage administratif commun, une validation suppose une approbation volontaire, un agrément donné à une décision prise de manière autonome. L’imposition d’office d’un budget par l’autorité préfectorale, mécanisme de dernier recours prévu par le législateur pour pallier les défaillances des organes délibérants, constitue davantage un acte de contrôle qu’une marque d’adhésion.
Cette confusion sémantique entre contrôle administratif d’urgence et validation bienveillante mériterait, dans un souci de transparence démocratique, d’être clarifiée auprès des citoyens contributeurs.
III. La rhétorique compassionnelle face aux contradictions opérationnelles
Citation 3 : L’indignation philosophique
L’éditorial développe ensuite une réflexion sensible sur la précarité alimentaire :
« L’alimentation est la variable d’ajustement dans les budgets«
Et cite une sociologue dénonçant le fait de :
« Nourrir les pauvres avec ce qui devait être jeté«
Ce qu’il faut comprendre : Ces considérations éthiques, pour nobles qu’elles soient, entrent en collision frontale avec les données chiffrées du rapport lui-même. Comment, en effet, dénoncer avec emphase l’instrumentalisation de l’alimentation comme « variable d’ajustement » lorsque, dans le même document, on apprend que :
- Le taux de gaspillage alimentaire atteindrait 40,3%
- Quatre tonnes de denrées seraient redistribuées aux associations caritatives
- La part du bio aurait chuté de 36,4% à 27,8% en l’espace de deux années
- Le nombre de composantes par repas serait passé de cinq à quatre
Le SIPLARC pratiquerait donc précisément ce que son éditorial dénonce avec vigueur : traiter l’alimentation comme une variable d’ajustement budgétaire et redistribuer aux plus démunis ce qui n’a pu être servi. Cette dissonance entre les principes proclamés et les pratiques documentées interroge la cohérence du discours institutionnel.
Citation 4 : L’engagement pour la dignité
L’éditorial affirme solennellement :
« Bien manger, au moins une fois par jour, est l’exigence vitale, le lien social, le socle d’humanité à ne pas dégrader«
Ce qu’il faut comprendre : Cette exigence de dignité alimentaire, que nul ne saurait contester, se heurte aux décisions opérationnelles documentées dans le rapport. Comment concilier l’ambition affichée de « bien manger » avec la diminution simultanée de la part du bio, la réduction du nombre de composantes, et le maintien d’un taux de gaspillage supérieur à 40% ? Ces arbitrages gestionnaires ne constituent-ils pas, précisément, une « dégradation du socle d’humanité » que l’éditorial prétend défendre ?
IV. Les remerciements révélateurs
Citation 5 : L’hommage aux équipes
L’éditorial conclut sur un hommage appuyé :
« Grâce aux compétences professionnelles et à l’engagement sans faille des fonctionnaires territoriaux et de la nouvelle équipe de direction générale qui nous accompagnent depuis septembre 2023«
Ce qu’il faut comprendre : Cette formulation suggère implicitement qu’avant septembre 2023, sous la présidence de Madame Bakhti-Alout, ces « compétences professionnelles » auraient fait défaut ou n’auraient pas été pleinement mobilisées. C’est reconnaître, en creux, que la gestion antérieure souffrait de carences graves en matière d’encadrement et d’expertise.
Par ailleurs, cette mise en lumière de la « nouvelle équipe » intervenue en septembre 2023 contraste singulièrement avec le silence observé sur le sort réservé aux précédents collaborateurs. Le rapport mentionne ailleurs le gel de trois postes de direction et le non-renouvellement de sept contrats à durée déterminée. Faut-il comprendre que ces départs, pour nécessaires qu’ils aient été dans la logique de redressement, constituent l’une des manifestations concrètes de la « régulation organisationnelle » si longtemps absente ?
V. Les questions légitimes demeurant sans réponse
Au terme de cette lecture critique, subsistent des interrogations que les citoyens noiséens, usagers et contributeurs du service public, seraient fondés à formuler avec insistance :
Sur la responsabilité gestionnaire : Comment peut-on dresser un réquisitoire aussi sévère contre une gestion « de court terme » caractérisée par des « arbitrages non éclairés » lorsqu’on en fut soi-même l’artisan pendant trois années et demie ? Quelles circonstances exceptionnelles auraient empêché, de 2020 à 2023, la mise en œuvre des mesures aujourd’hui jugées vitales pour la survie de l’établissement ?
Sur la transparence budgétaire : Les citoyens méritent-ils qu’on leur présente comme une « validation » ce qui s’apparenterait plutôt à une intervention préfectorale d’urgence ? La pédagogie démocratique n’exige-t-elle pas que l’on distingue clairement entre une adoption consensuelle et une imposition réglementaire ?
Sur les engagements tarifaires : Douze années sans ajustement tarifaire auraient conduit à l’accumulation d’un déficit que le rapport chiffre à 894 000 euros pour la seule commune de Noisy-le-Sec. L’augmentation annoncée pour avril 2025 interviendra-t-elle effectivement, ou faut-il redouter un nouveau report assorti d’explications philosophiques ?
Sur la qualité du service rendu : Comment justifier la diminution conjointe de la part du bio, du nombre de composantes et l’absence de maîtrise du gaspillage, tout en dissertant sur l’impératif de « bien manger » et sur la « dignité humaine » ? Les enfants noiséens ne méritent-ils pas que les actes soient à la hauteur des discours ?
Conclusion : De la grandeur démocratique et de l’exigence républicaine
Les citoyens de Noisy-le-Sec, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical, ne sollicitent point de références savantes à Marcel Mauss ni de considérations sociologiques sur le « fait social total ». Ils attendent, plus modestement mais plus fondamentalement, ce que le pacte républicain leur garantit : la transparence dans la gestion des deniers publics, la cohérence entre les principes affichés et les actes posés, l’honnêteté dans la présentation des difficultés rencontrées.
La grandeur démocratique ne réside pas dans l’habileté rhétorique à transformer les échecs en victoires, ni dans l’art de masquer les responsabilités sous les voiles de la grandiloquence. Elle se manifeste dans cette capacité, infiniment plus difficile, à regarder la réalité en face, à assumer ses erreurs avec franchise, à rectifier sa trajectoire avec humilité.
Un établissement public qui frôle la dissolution mérite mieux qu’un exercice littéraire, fût-il brillant. Les enfants qui fréquentent nos cantines scolaires méritent mieux que des discours sur la dignité alimentaire pendant que la qualité de leurs repas régresse. Les contribuables noiséens méritent mieux que des euphémismes administratifs lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi le Préfet a dû se substituer aux organes délibérants défaillants.
C’est au nom de cette exigence républicaine élémentaire, sans animosité personnelle mais avec la fermeté qu’impose le respect de nos institutions, que ces observations sont respectueusement soumises à votre réflexion. Car la démocratie locale se nourrit du dialogue franc entre gouvernants et gouvernés, non de la sophistique administrative qui éloigne les citoyens de la chose publique.
Puissent ces remarques contribuer, non à alimenter une polémique stérile, mais à restaurer cette confiance démocratique sans laquelle aucun service public ne peut durablement prospérer. Madame Julie Grünebaum, les Noiséens vous demandent simplement la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité !
Car voyez-vous, Madame Grünebaum, les enfants de Noisy-le-Sec, eux, ne lisent pas Marcel Mauss entre deux bouchées à la cantine.
Ils constatent simplement qu’il y a moins de bio dans leurs assiettes, moins de choix, mais toujours autant de beaux discours sur la « dignité alimentaire » pendant que leurs parents, eux, s’agacent du prix des repas scolaires à payer , toujours plus élevé.
Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.Les faits, citations et témoignages évoqués reposent sur des éléments disponibles, des documents syndicaux publics et des informations d’intérêt général au moment de la publication.Aucune imputation personnelle de nature diffamatoire n’est formulée à l’encontre d’un individu déterminé.
L’article relève d’une démarche d’information et d’analyse sur le fonctionnement institutionnel d’une collectivité publique, sans intention de nuire ni d’atteindre à l’honneur d’une personne.Toute précision ou rectification documentée sera naturellement publiée à la demande des intéressés dans le respect du droit de réponse.